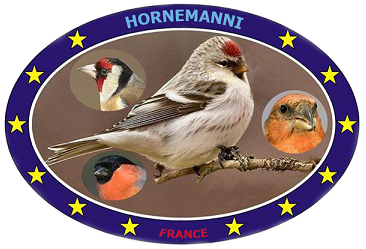Conduite de l’élevage
La période hivernale
De fin octobre, début novembre à début mars, les mâles reproducteurs sont séparés des femelles reproductrices. Les Verdiers sont alors placés en volières spacieuses ou ils passeront tout l’hiver.
Fin octobre est également le moment conseillé pour commander ses bagues fermées en aluminium de couleur. Les sujets destinés aux expositions sont déjà en cages d’élevages depuis un bon mois et se préparent tranquillement pour les grands rendez-vous. A la fin de la période d’exposition, ils seront lâchés également en volière après une cure de vitamines.

Exemple de volière d’extérieur

Exemple de volière d’extérieur

Exemple de volière d’extérieur

Exemple de volière d’extérieur

Exemple de volière d’intérieur

Exemple de volière d’intérieur
Pendant cette période, et plus particulièrement si les oiseaux sont logés dans des locaux non chauffées, il est conseillé de distribuer un régime alimentaire plus enrichi que d’ordinaire.
Pour compléter le mélange de graines, on peut distribuer régulièrement du petit tournesol noir, du millet roux en grappe. Une fois par semaine, une pâtée sèche enrichie de perle morbides, de vitamines et d’oligoéléments, est mise à la disposition des oiseaux. L’hiver, la conservation des perles morbides mélangée à la pâtée d’élevage ne pose pas de problèmes de conservation. On, peut distribuer par petites doses des fruits ou certaines graminées si le temps est clément. En fonction de la météo, et depuis quelques années du fait du réchauffement climatique, il n’est pas rare de trouver quelques plantes distribuables tout l’hiver. A partir de fin février on trouve même du mouron blanc et des pissenlits dans le Sud-Ouest.
En février une cure de 5 jours avec un anticoccidien est recommandé. De nombreux produits sont disponibles sur le marché, la plupart sont délivrables sur ordonnances.
L’utilisation de produits naturels est également possible mais n’impacte pas les coccidies. On peut utiliser du vinaigre de cidre bio non pasteurisé. La posologie est de 1 cuillerée à soupe pour 1 litre d’eau pendant 5 jours.
En période de grand froid, un complément alimentaire à base de glucose est particulièrement recommandé.
Le grit, l’os de sèche sont toujours présents dans les volières.
On surveillera particulièrement le taux d’humidité du local d’élevage, et en cas d’hébergement en volière extérieure, on veillera à ce que les oiseaux disposent d’un endroit abrité du vent et des intempéries.
La période hivernale coïncide avec la période des grands nettoyages. Il est préférable de prévoir une volière ou deux en fonction du nombre de sujets pour effectuer des rotations permettant de laver et de désinfecter les locaux et les installations.
Pour le traitement des parasites externes, et éliminer les risques de gale, l’application de deux gouttes d’ivermectine en solution diluée, sur la partie interne de l’aile au niveau de l’avant-bras est conseillée. L’utilisation d’un compte-goutte ou d’un coton tige sont à utilisés pour le traitement. Attention cependant à ne pas dépasser la dose indiquée. Un surdosage aura pour conséquences la mort de l’oiseau dans 2 cas sur 3. Pour les cas de gale, je dépose les gouttes directement sur une des pattes atteinte.
C’est également la période idéale, pour améliorer les installations, laver réparer le matériel, réfléchir à l’implantation des oiseaux pour la saison suivante. Il est à ce sujet recommandé de prévoir plusieurs schémas d’accouplements, style plan B ou C, car l’hiver est long, et ne seront accouplés que les oiseaux en parfaite condition.
C’est en février que sont constitués les couples reproducteurs. L’éleveur doit alors tenir compte de différents paramètres pour réaliser ses accouplements.
La taille et la forme :
Il est important de choisir des oiseaux soit complémentaires soit présentant une taille et une forme conforme au standard. N’oubliez pas qu’un verdier est un oiseau robuste.
Le plumage :
Il faut tenir compte de la structure de la plume et donc bien observer ses oiseaux. Une plume longue ou schimmel devra être accouplée avec une plume courte ou intensive, voire semi-intensive. Les éleveurs de canaris connaissent très bien se principe. Par contre chez les passeriformes européens, et notamment les verdiers, la notion d’intensif et de schimmel est beaucoup moins connue.
Deux oiseaux à plumes longues accouplés ensemble pourront donner dans leur descendance des oiseaux présentant une plume encore plus longue. De schimmel en schimmel, on fini par obetenir des oiseaux présentant une plume lâche sur les flancs, des ouvertures à la poitrine, une couverture des cuisses et des pattes fautive, et même des lumps propres aux canaris de postures. Les lumps sont des kystes folliculaires comparables aux poils incarnés chez l’être humain. La plume en poussant, ne se développe pas à l’extérieur du corps de l’oiseau et constitue une boule sous la peau. Ce type de pathologie peut provoquer des infections et la mort à terme de l’oiseau. Si un verdier présente des kystes folliculaires, il est préférable de ne pas l’utiliser en élevage. Cette pathologie, fréquente chez les canaris de posture est très rare chez les verdiers. Sur un plan préventif, des bains quotidiens permettent un assouplissement de la peau et favorisent la pousse des plumes.
La couleur :
Pour les sujets de couleur ancestrale, il faut accoupler des oiseaux lumineux et surtout pas ternes. Un plumage terne peut également exprimer une carence alimentaire ou un problème de condition générale. Les femelles ancestrales présentent généralement beaucoup de phaéomélanine brune. Les mâles ont un plumage beaucoup plus vert et lumineux. Attention cependant, les jeunes mâles de première année présentent bien souvent beaucoup plus de phaéomélanine que les mâles adultes On peut donc, en fonction de ses choix et des ses objectifs, créer des lignés mâles ou des lignées femelles.
Les lignées mâles seront issues de femelles présentant le moins de brun possible. Les lignées femelles seront créées avec des femelles très brunes et des mâles tirant vers le noir brun.
Pour les mutations, il faut accoupler les oiseaux en fonction des objectifs recherchés. Ce qui est vrai pour les phénotypes ancestraux est également vrai pour les phénotypes et génotypes mutés. Vous pourrez créer vos lignées mâles et femelles. Il sera donc important de connaître le phénotype et le génotype de vos reproducteurs, sans oublier les liens de parenté. Un arbre généalogique peut être très utile lorsque l’on souhaite fixer un caractère. Attention également aux accouplements déconseillés. Un prochain article sera consacré à ce sujet.
Le toilettage :
Il est recommandé de couper l’extrémité des ongles des oiseaux, pour faciliter les accouplements. Un mâle avec des ongles long aura du mal à féconder la femelle, si ses ongles sont pointus la femelle se dérobera au moment de l’accouplement lorsqu’il les plantera dans son dos. La femelle avec des ongles longs sera beaucoup moins stable sur les perchoirs, et si ses ongles sont pointus, pourra griffer ses œufs pendant la couvaison.
La période de préparation à la reproduction
Nous sommes désormais début mars. Le soleil se lève chaque jour deux minutes plutôt et se couche en moyenne deux minutes plus tard. Les dimer sont réglés en fonction de la durée de la lumière extérieure si vous élevez en local intérieur.
Les Verdiers et leur soigneur commencent à s’impatienter. Les installations sont propres. Les oiseaux sont par couples dans les petites volières. Dans les plus grands espaces, les 4 à 5 femelles verdiers sont courtisées par le mâle sélectionné. La période de reproduction est proche.
On trouve de plus en plus de graminées sauvages dans les champs et ls jardins, et plus précisément le mouron blanc et le pissenlit. Les mâles lancent des trilles joyeux et des notes étirées et chuintantes « chuiiiiiiii ». Certaines femelles commencent à véhiculer des plumes ramassées dans la volière ou des brindilles et des fines radicelles séchées. On observe que les mangeoires sont régulièrement vidées de leurs graines pour laisser la place à ces mêmes brindilles. Les femelles se préparent à nicher.
L’erreur consiste alors à se précipiter et installer les nichoirs en urgence. En effet, si les femelles commencent à être prêtes, ce n’est pas encore le cas des mâles. Les mâles sont en effets prêts à reproduire, trois semaines environ après les femelles. Ceci explique que bien souvent, lorsque l’éleveur est trop pressé d’installer les nids, il constate des pontes majoritairement claires. Il faut toutefois être conscient que freiner des femelles à la reproduction et tenter de les faire patienter peut échouer et se terminer avec des pontes dans les mangeoires ou sur le sol de la volière.
Il est donc recommandé d’affiner la préparation en distribuant une pâtée sèche, additionnée de vitamines E, d’oligos éléments et des vitamines . le tout complété de perles morbides ou de graines germées. Cette pâtée quotidienne sera donnée aux verdiers jusqu’à la ponte du premier œuf.
Précaution importante, ne pas surdoser les vitamines E, car les conséquences seraient alors de voir les oiseaux et plus particulièrement les mâles, détruire les nids, empêcher les femelles de couver, casser les œufs jusqu’à même les manger, et tuer les jeunes poussins à la naissance.
En complément de la pâtée, des graminées mures et mi- mures peuvent être distribuées aux oiseaux., en respectant les mesures de précautions à adopter lors de la cueillette. Un article est en préparation sur ce sujet.
Personnellement, fin mars, en règle générale, je décide d’installer les nids. Je suspends alors dans les volières des planches en bois sur lesquelles sont fixées des nids métalliques. Des bouquets de thuyas, ou de genets, fixés également sur les supports en bois, camouflent les futurs lieux de nidification. A l’intérieur des nids métalliques ou grillagés, sont déposés une coupe en chanvre permettant aux oiseaux d’assembler plus rapidement et plus facilement la structure de leur nid.
Elever par couple ou en polygamie ?.
J’élève depuis des années suivant les deux méthodes.
Par couple, en petite volière ou en cage spacieuse, il faut être vigilant et surveiller le comportement du mâle. Si ce dernier es trop excité par un apport vitaminé trop important, il peut chasser la femelle détruire le nid, casser ou manger les œufs, tuer les jeunes à l’éclosion ou la veille de l’éclosion. Heureusement, ces différents scénarios catastrophes ne sont pas à généraliser, et bien souvent le mâle s’occupera parfaitement de sa femelle. Si cependant vous rencontrez un tel comportement, n’hésitez pas à séparer le mâle de sa femelle la veille de l’éclosion. Il faut alors le placer dans une cage d’exposition à l’intérieur de la volière. Ainsi la femelle l’entendra et continuera aussi à le voir. Une fois la ponte de l’œuf terminée, il faudra le remplacer par un œuf factice et relâcher le mâle avec sa femelle. A la ponte du cinquième œuf, le mâle retrouvera sa cage d’exposition pour la durée de couvaison, voire plus.
En polygamie, à savoir un mâle avec 5 à 6 femelles, en fonction de la taille de la volière, les problèmes évoqués précédemment sont beaucoup plus rares. Le mâle doit se consacrer à toutes les femelles, et dépense beaucoup plus d’énergie. Généralement, les femelles commencent à couver les unes après les autres dans la tranquillité. Par expérience, toujours, si par contre un mâle commence à détruire les nids ou manger les œufs, il est inutile d’insister et il est alors préférable de le remplacer et de rayer de la reproduction.
Evitez également de former un trio. Dans ce cas, on peut voir les femelles s’accoupler et laisser le mâle de côté. Plus grave, la femelle ou le mâle passera son temps à chasser l’autre femelle.
La période d’élevage
Nous sommes fin mars, les verdiers sont au top de leur forme. Les mâles chantent et pourchassent les femelles. Ces dernières transportent dans leur bec le moindre matériel pour commencer la nidification. Il est temps de suspendre les nids. La lumière artificielle et naturelle s’allonge de jour en jour. En moyenne 2 minute le matin et une à deux minutes le soir. Lorsque la température est d’au moins 13 à 14° et que la durée de lumière est de 14 à 15 Heures. Les conditions de reproduction sont idéales.
Une fois positionnés sur le support, il n’est pas rare de voir le mâle aller d’un nid à l’autre. Certains déposent même une herbe, une plume, comme pour marquer le choix final de l’emplacement.
Par expérience, il est fréquent de voir les nids se construire dans la journée. Si vous avez opté pour une volière plantée, ou si vous positionnez des fagots de genet ou de thuyas dans les volières, vous aurez sans aucun doute la chance de voir se construite de véritable nid naturel sans aucun support artificiel. Ceci prouve que malgré des décennies de d’élevage en captivité, le Verdier conserve encore des reflex propres à son espèce.
Dans les nids avec support, j’ai pris pour habitude de disposer une coupe de chanvre, utilisée en canariculture, pour aider la femelle à fixer les matériaux de nidification. La base du nid est généralement constituée de fibres de cocos, d’herbes, de radicelles, de mousse, pour ensuite est garnie de matériaux plus doux, comme le poil de chèvres, le poil de lapin, le coton (100% naturel), le coton de saule. La femelle s’applique énormément à la construction de son nid. Bien souvent elle le construit, le détruit, le reconstruit, le détruit, le reconstruit, change d’emplacement et au final le termine dans un des endroits déjà visité. Quelquefois, ce sont les mâles qui décident de revoir la construction du nid et jettent les matériaux accumulés par la femelle. Les jeunes femelles ont plus de difficulté à construire leur premier nid. Il faut donc s’armer de patience.
Une fois le nid terminé, la ponte du premier œuf ne tarde pas. Période particulièrement sensible ou l’éleveur doit faire preuve d’observation, et plus particulièrement concernant les jeunes femelles. En effet, on anticipe la ponte en observant le ventre des femelles verdiers et leur comportement. Certaines restent posées sur un perchoir ou une branche, d’autres restent déjà au nid comme si elles avaient commencé à couver. En fonction de la météo, et surtout de la température, il est conseillé d’être présent le matin au moment des pontes. A la ponte du premier œuf j’arrête la distribution de la pâtée enrichie.

Les œufs peuvent être retirés chaque jour, remplacés par des œufs factices. Il faut cependant les placer sur un lit d’alpiste et les retourner plusieurs fois par jour.

Parenthèse concernant le mal de ponte
Le risque majeur est le mal de ponte. Celui-ci se diagnostique le matin. La femelle est alors gonflée, elle est posée sur son perchoir voire aussi à même le sol, les ailes parfois pendantes, les yeux mi-clos. Il y a danger ! On peut observer ces symptômes la veille de la ponte, ce qui est encore plus grave. Le travail est en cours mais se passe mal. Comme la femelle n’arrive pas à évacuer l’œuf, elle s’épuise et si l’éleveur n’intervient pas rapidement, elle mourra. Si on s’aperçoit la veille que la femelle est en souffrance, il faut la placer dans une cage hôpital, ou une cage d’exposition proche d’une source de chaleur. Le fond de la cage est recouvert de mousse pour amortir la chute de l’œuf si elle finit par l’évacuer naturellement. Un seul perchoir est suffisant le plus bas possible. Distribuez de l’eau avec un mélange à base de glucose pour donner un effet de stimulation. Si besoin, mettez directement la composition liquide dans le bec de l’oiseau. L’énergie produite par l’absorption du glucose, conjuguée à la chaleur permettra à la femelle verdier de reprendre des forces et si tout se passe comme prévu de pondre normalement.
Si l’éleveur s’aperçoit trop tard du mal de ponte, c’est-à-dire le matin, car les verdiers pondent entre huit heures et huit heure trente, il faut provoquer la ponte de l’œuf. L’intervention n’est pas sans risque. Il faut déjà dans un premier temps prendre l’oiseau le plus délicatement possible en évitant de compresser le ventre de la femelle. Une fois en main, plusieurs techniques sont possibles.
L’objectif prioritaire est de sauver la femelle, donc peu importe si l’œuf se casse après l’évacuation. La technique de la casserole avec de l’eau bouillante est la plus commune. Placez l’oiseau au-dessus d’une casserole d’eau bouillante dégageant de la vapeur d’eau. Testez au préalable avec la main la chaleur de la vapeur pour ne pas brûler l’oiseau. Il faut donc tenir l’oiseau à bonne distance, le ventre exposé à la vapeur qui se dégage de la casserole. Cette source de chaleur et d’humidité contribuera à dilater le cloaque. Une fois le ventre chauffé, introduisez à l’aide d’une pipette, une à deux gouttes d’huile d’olive. Vous pouvez également utiliser un coton tige trempé dans de l’huile d’olive. On peut également masser doucement le ventre de la femelle avec le coton tige en prenant soin de ne pas appuyer et toujours dans le même sens, vers le cloaque. Une fois l’opération réalisée, laissez la femelle dans la cage d’exposition ou la cage hôpital et maintenez-là à bonne température, 28 à 30°. Placez la cage dans un endroit calme. La logique est de voir l’oiseau évacuer l’œuf quelques minutes plus tard.
Si par malheur, lors des manipulations, l’œuf est brisé à l’intérieur du ventre de la femelle, et quelle ne peut pas l’évacuer, cette dernière sera condamnée.
Il arrive également que certaines femelles évacuent l’œuf collé à l’oviducte. Dans ce cas également les chances de survie de l’oiseau sont nulles.
Le mal de ponte est propre à toutes les espèces d’oiseaux. Elle n’est pas fréquente chez les Verdiers, mais il faut en avoir connaissance et se tenir prêt si besoin.
Ces précisions effectuées, revenons sur le déroulement de la ponte. 5 œufs en moyenne, bleutés, sont déposés chaque matin dans le nid par la femelle verdier. Certaines femelles se contentent de pondre quatre œufs d’autres six œufs. La couvaison commence en règle générale dès le troisième œuf, mais j’ai déjà observé des oiseaux qui couvaient à la ponte du dernier œuf, d’autres dès la ponte du premier. Personnellement, je préfère laisser les œufs dans le nid et ne pas les remplacer chaque jour par des œufs factices jusqu’à la fin de la ponte. Je laisse donc faire la nature avec le risque du décalage des naissances. On peut en effet, avoir 5 jours d’écart entre le premier jeune et le dernier, dans ce cas le dernier jeune à peu de chance de survivre. La solution consiste alors à le placer dans le nid d’une femelle ayant des jeunes du même âge et de même taille, ou de compléter sa nourriture avec une seringue.
Entre le 6° et le 8° jours de couvaison, je mire les œufs à l’aide d’un mire œuf acheté en animalerie. Les œufs fécondés sont facilement identifiables. On distingue nettement les vaisseaux sanguins de l’oisillon ainsi que la poche d’air qui se développera également au fil des jours en fonction de la croissance de l’embryon. On peut distinguer les battements de cœur de l’embryon. Un œuf clair est translucide. Un embryon qui ne se développe pas ou qui est mort se distingue par un point sombre au centre de l’œuf. Je profite du mirage pour soupoudre le nid et les œufs avec une poudre insecticide et préserver la femelle et les futurs jeunes des attaques de poux gris et surtout rouges.
La femelle Verdier couve seule, certains mâles couvent également mais ils sont rares. La durée de couvaison est de 13 jours. L’idéal est de disposer d’un taux d’humidité dans l’élevage de 65%. Deux jours avant l’éclosion, la coquille des œufs change d’aspect et devient plus claire et plus mate. Les œufs clairs sont brillants et terne. Le bain est présent en permanence dans la cage ou la volière. Si les œufs n’éclosent pas, il faut être prudent et se donner quelques jours avant de les casser. Il n’y a pas de règle précise concernant la couvaison. Certaines femelles couvent dès le premier œuf, d’autres au troisième, d’autres au dernier. Par conséquent il est bien difficile de prévoir la date exacte de l’éclosion, surtout lorsqu’on laisse faire la nature.

Lorsque le jeunes naissent, les femelles verdiers qui sont particulièrement propres, prennent le soin d’enlever les coquilles et de la placer loin du nid. Il n’est pas rare de les retrouver dans la mangeoire. Si c’est le cas, c’est parfait pour l’éleveur qui n’a pas à se poser des questions, les jeunes sont nés.
Le régime alimentaire est alors le suivant : Mélange de graines habituel, pâtée sèche vitaminée enrichie de perles morbides, de pinckies décongelés et de petit tournesol noir, millet en grappe, pomme fraiche, du périlla gris, et des graminées sauvages à profusion. La première couvée coïncide avec la période de récolte du mouron blanc, du pissenlit et des premiers laiterons maraîchers.

perles morbides, pâtée + graines germées


perles morbides, pâtée + graines germées
Jeunes verdiers en mutations de couleurs : simples et doubles dilutions bec jaune

Jeunes verdiers brun, agate et Isabelle

Jeunes Isabelle satiné et simples dilutions
A environ 15 jours les jeunes quitteront le nid et commenceront à voler. Les premiers jours, ils restent la plupart du temps au sol. Il est recommandé de disposer dans la volière une branche d’arbre qui leur permettra de grimper branche par branche pour atteindre les perchoirs supérieurs. Laissez faire la nature, vos oisillons seront rapidement aptes à se percher normalement. Dans le même temps, la femelle verdier repars pour une deuxième ronde, après avoir construit un nouveau nid dans un autre nichoir. Elle sera bien souvent dérangée par ses jeunes pendant la durée de la couvaison, jusqu’au sevrage de ces derniers s’ils sont déplacés dans un autre environnement. On constate souvent que les jeunes de première couvée viennent squatter le nouveau nid et bien souvent occasionnent de nombreux dégâts. Les œufs peuvent être cassés, leurs fientes souillent les œufs, la femelle est tellement dérangée qu’elle abandonne la deuxième couvée… Il faut de toute façon garder à l’esprit que l’objectif prioritaire est d’assurer la première couvée en cours de sevrage et ne pas courir après 100% de résultats positifs. L’élevage amateur, ne doit pas être pratiqué avec un esprit quantitatif, prioritairement qualitatif. Ceci explique pourquoi, la deuxième couvée est bien souvent ratée. La troisième couvée coïncidera avec le sevrage des jeunes ce qui permettra à la femelle de couver et d’élever en toute tranquillité, pour peu que le mâle la laisse tranquille également. Lorsque les jeunes quittent le nid, j’ai pour habitude de réduite de façon très importante les graminées sauvages et d’arrêter les graines germées. Sinon, les jeunes ne mangeront que ce qu’ils aiment et ce qui est facile à picorer, la verdure et les germes de graines. Un tel régime provoquera des entérites, fragilisant l’organisme des oiseaux et générant elles-mêmes de nouvelles affections comme la coccidiose et surtout la lankesterelose. Je distribue toujours le même mélange de graines, de la pâtée sèche enrichie de perles morbides, et des graines de perilla gris à profusion, et bien sûr de la pomme fraiche tous les jours.
Les verdiers peuvent reproduire en cage d’élevage. La règle de base est de disposer de sujets d’élevage élevés dans des conditions similaires. Toutefois, la principale difficulté est de faire nicher la femelle. Le mâle, une fois en condition d’élevage s’accouplera lorsque la femelle sera prête à reproduire. L’éleveur devra cependant être vigilant, car le mâle dans un espace réduit pourra s’il est trop excité, perturber la femelle, détruire le nid, piquer les œufs, voire tuer les jeunes à la naissance. Dans de telles conditions d’élevage, il est recommandé de séparer le mâle après la ponte du dernier œuf, à l’aide d’une séparation grillagée. La femelle continuera ainsi à voir le mâle et élèvera seule sa nichée.
Lorsque les jeunes seront sevrés, il sera alors temps de replacer le mâle avec sa femelle. Attention, en procédant ainsi, la femelle peut très bien refaire une ponte à 15 jours, lorsque les jeunes sont sur le point de quitter le nid. Il faut dans ce cas, jeter les œufs non fécondés, et l’empêcher d’entamer une nouvelle couvaison en enlevant les nids temporairement. En effet, certaines femelles arrêtent de nourrir leurs jeunes à partir du moment où elles recommencent à couver. Les jeunes verdiers étant sevrés à partir de 30 jours dans ce cas, il faut s’armer de patience. Le principe est de préserver et d’assurer les résultats obtenus, avant de chercher à obtenir une nouvelle couvée.
Certains mâles, lorsque l’on enlève la grille de séparation acceptent immédiatement de nourrir les jeunes, d’autres pas. C’est à l’éleveur de s’adapter.
Le baguage :
Le baguage est une étape particulièrement importante pour l’éleveur.
Chaque année, conformément aux directives de la confédération ornithologique mondiale, les fédérations commercialisent des bagues à la couleur du millésime. La bague fermée est la carte d’identité de l’oiseau.
Lors du baguage, qui se déroulera de préférence le soir vers 19H, il faudra être attentif au comportement de la femelle, lui parler pour la rassurer s’il le faut et surtout ne pas l’affoler. Procéder par gestes lents.
Les bagues seront recouvertes de sparadrap couleur chair afin de masquer la couleur de la bague ou sa brillance. Si les jeunes sont bagués trop tôt, les femelles par réflexe de propreté veulent enlever les bagues de leurs jeunes et quelquefois s’énervent pour y arriver au point de mutiler leurs oisillons et même les jeter sur le sol de la volière. C’est pourquoi il faut faire preuve de prudence et baguer au bon moment. On a pour habitude d’attendre que les premières fientes restent déposées sur les rebords du nid, signe que la femelle baisse sa garde concernant la propreté du nid. C’est un indicateur, mais si les jeunes sont bien alimentés, leur croissance fait que le baguage devient alors difficile voire impossible au risque de les blesser.

Baguage avec un camouflage de la bague

Le baguage doit se faire au bon moment, ni trop tôt ni trop tard…
Comment procéder au baguage ?
Le baguage des jeunes verdiers a lieu vers le 6° ou le 7° jour. La patte est humectée à l’aide d’un peu de salive. D’une main l’éleveur maintien la patte de l’oisillon et de l’autre enfile la bague fermée. Les trois premiers doigts sont passés, et viennent ensuite glisser sur l’articulation. L’éleveur doit prendre soin de faire tourner la bague en avançant doucement, massant l’articulation et en tirant légèrement sur les trois premiers doigts. Le doigt antérieur est passé ensuite et l’éleveur doit remonter la bague pour le dégager rapidement. Il suffit ensuite de redescendre la bague le long de la patte et terminer en faisant bouger les doigt pour vérifier que l’articulation fonctionne parfaitement. Pour faciliter la réussite de la dernière étape, on peut utiliser, avec beaucoup de précaution, un cure dent pour faire glisser la bague sur le dernier doigt.
![]()
Pour limiter les risques synthèse de quelques recommandations :
- Ne baguer qu’à partir du moment où la femelle ne nettoie plus parfaitement le nid.
- Baguer de préférence le soir vers 19H. La femelle oubliera pendant la nuit, le dérangement occasionné par le baguage.
- Camoufler la bague avec du sparadrap couleur chair. L’objectif est de masquer la brillance de la bague. Les meilleurs résultats sont obtenus en recouvrant les bagues avec du sparadrap fin plastifié de couleur chair.
Certains éleveurs utilisent le noir de fumé ou le feutre noir pour cette opération. Après avoir testé différentes méthodes de camouflage, je pense que les meilleurs résultats sont obtenus avec le sparadrap.
Le diamètre de la bague :
Il doit impérativement être adapté à l’espèce ou la sous-espèce que l’on élève. On ne bague pas un verdier de la sous espèce auriventris avec les même bagues qu’un verdier major Maltais. Ne jamais baguer avec un diamètre trop petit. Les diamètres de bagues que je préconise d’utiliser vont de 2.9 mm à 3.2 mm.
Les accidents liés au baguage :
- La femelle débague ses jeunes. Lorsque la femelle veut enlever la bague de la patte de son jeune, elle tire sur la bague et retourne le doigt inférieur. La patte présente alors une déformation grave dans la mesure où le doigt blessé ne peut plus saisir le perchoir et que l’oiseau repose sa patte sur le doigt plié ce qui accentue la blessure. Il faut dans ce cas rééduquer très vite la patte de l’oisillon. Les meilleurs résultats sont obtenus en maintenant le doigt déformé relevé, à l’aide d’une bande de sparadrap, d’une bague de cellulose. Au fil des jours, le sparadrap se détendra et le doigt reprendra une position normale. Cette solution a été expérimenté avec succès à plusieurs reprises dans mon élevage. Certains jeunes retrouvent un fonctionnement normal de la patte et plus aucune déformation n’est visible. D’autres conservent une raideur du doigt inférieur qui les écartera des expositions mais pas de l’élevage.

Doigt retourné suite à un dé baguage réalisé par la mère

Correction du positionnement du doigt et placement du sparadrap

L’oisillon peut positionner ainsi normalement sa patte sur le perchoir et effectuer lui-même la rééducation.
- Jeunes jetés hors du nid. Accidents rares chez les Verdiers. Plus fréquent chez les Tarins et les bouvreuils. La solution : ne pas baguer trop tôt les oisillons et surtout bien camoufler le brillant de la bague. Il faut replacer les jeunes dans le nid et observer. Si la femelle ou le mâle recommencent, le plan B consiste à trouver une mère adoptive.
- Bague d’un diamètre trop faible. Cette erreur grave est provoquée par une méconnaissance de la sous-espèce et du diamètre de bague adapté. La solution est de couper rapidement la bague à l’aide d’un ciseau spécial vendu en animalerie. Attention, un oiseau débagué et concerné par la règlementation devra être bagué par un organisme officiel habilité avec une bague ouverte que l’on colle après la pose en rejoignant les deux extrémités.
Le sevrage des jeunes
Le sevrage est LA période sensible et à haut risque pour l’éleveur et surtout pour les jeunes verdiers. Après une trentaine de jour, les oisillons mangent seuls. Plusieurs solutions sont envisageables. Quand la volière est grande, on peut choisir de laisser les jeunes dans la volière de reproduction. Ils continueront à être nourris par leurs parents, alors que leur mère sera en cours d’élevage de la deuxième couvée. Fonctionner de cette façon offre un certain confort, et aussi des désagréments. En effet, en cas de traitement préventif des jeunes oiseaux, vous devrez également par obligation traiter les parents.
L’idéal est de loger les jeunes sevrés dans une autre volière uniquement consacrée aux jeunes de l’année. L’alimentation est sèche et composé du mélange habituel, de la pâtée sèche vitaminée et complétée de perles morbides et d’un peu de petit tournesol noir, de pommes fraiches, et de millet en grappe. Entre le 30° et le 60°jour, les risques de mortalité rapides sont à redouter. L’oiseau semble en condition le matin alors qu’il déjà infecté et amaigri, commence à gonfler son plumage à la mi-journée, et en fin de journée repose sur le fond de la volière. On pense alors à la coccidiose, mais surtout à la lankesterelose. Pour les protéger, les jeunes reçoivent un traitement dans l’eau de boisson à base de sulphadimétoxine. Vous trouverez cette molécule chez votre vétérinaire. On peut également utiliser des tisanes naturelles à base de thym. Personnellement j’ai opté depuis plusieurs années pour la première solution en préventif des possibles affections. Les symptômes décrit précédemment sont ceux que les anciens éleveurs appelaient « la maladie du Verdier » qui frappe également les jeunes de l’année au moment de la mue juvénile. A l’époque 50 à 70 % des jeunes mourraient au sevrage ou pendant la mue. Désormais, ce risque est limité à condition d’effectuer un traitement préventif.

La mue
La mue des jeunes survient entre le deuxième et le troisième mois. Début août, les premières rémiges et rectrices des adultes tombent également une à une, la mue commence pour se terminer à la mi-septembre. Il est bon d’administrer un complexe polyvitaminé aux oiseaux durant cette période. Cette partie de l’année est certainement la plus difficile pour les oiseaux, quel que soit l’espèce et aussi la plus angoissante pour l’éleveur. Les efforts d’une saison peuvent être réduits à néant en quelques jours à l’approche de l’automne. On constate que les jeunes immatures sont les plus sujets à problèmes durant la mue. Il ne faut pas oublier qu’ils ont à constituer leur plumage par deux fois en l’espace de quelques mois. Les jeunes ne perdent normalement pas les premières rémiges ainsi que les premières rectrices à la première mue, ceci l’imitant quelque peu la fatigue de leur organisme. Ce n’est cependant pas toujours le cas, et certaines années, en fonction de la météo, de la chaleur, les jeunes verdiers perdent l’intégralité de leur plumage. Il est recommandé de ne pas les déplacer et les exposer aux courants d’air durant cette période. Le stress occasionné par un changement d’environnement augmentera leur fragilité générale. Il est conseillé de laisser les jeunes dans leur volière de sevrage jusqu’à la fin complète de la mue. Si l’on constate qu’un oiseau commence à gonfler son plumage, présenter un ventre également gonflé, avoir un regard triste, fermer les yeux, voire dormir pendant la journée, la catastrophe est proche. Il faut dans ce cas réagir très vite, placer l’oiseau malade en cage hôpital à 30°, et lui administrer un traitement anticoccidien pendant 5 à 7 jours. Ensuite le rebooster en reconstituant sa flore intestinale avec des ultras levure, puis des vitamines et des oligos éléments. On peut également observer un arrêt de la mue chez les jeunes oiseaux et plus rarement chez les adultes. Chez le jeune, une ou deux nouvelles plumes colorées apparaissent au niveau de la poitrine, et la mue semble s’arrêter. Ce processus que j’appelle blocage de la mue est bien souvent mortel. Une mue qui se déroule bien commence de façon symétrique par les flancs pour finir au niveau de la tête.
PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES DANS CE- TYPE D’ÉLEVAGE –
Agressivité de certains mâles, le mâle pique les œufs ou les mange :
Plusieurs techniques : séparer le mâle et le laisser en cage d’exposition, injecter dans des œufs clairs un produit désagréable et non nocif et les placer dans le nid. Certains utilisent un produit à base de piment.
Œufs mangés par la femelle (sans solution !) : femelle impropre à la reproduction. Maintenant, si l’oiseau est particulièrement important pour votre élevage : beauté, capital génétique important, mutation rare…il reste la technique d’injection de produits désagréables dans des œufs que l’on placera dans le nid. Et si vous avez le temps, intervenir dès que la femelle a pondu pour sauver l’œuf et le confier à une femelle de substitution.
Mortalité des embryons en cours d’incubation aux alentours du 7ème jour : fragilité des embryons dans le cas de mutations. Bactérie transmise dans l’œuf par les fientes de la mère. Dans le deuxième cas, une analyse approfondie avec antibiogramme peut s’imposer.
Mortalité dans l’œuf à la veille de l’éclosion : possible en cas de forte sécheresse et donc faible hygrométrie.
Mortalité des jeunes mutants à la naissance (fragilité des poussins en mutation de couleur),
Sevrage difficile, quand le mâle ne nourrit pas pendant que la femelle couve de nouveau.
Fragilité des jeunes durant leur premier hiver si ce dernier est particulièrement humide.